La Fondation Leenaards cherche à accompagner les mutations de la société en soutenant des projets et en stimulant des initiatives dans les domaines culturel, âge & société et scientifique, au sein de l’arc lémanique.
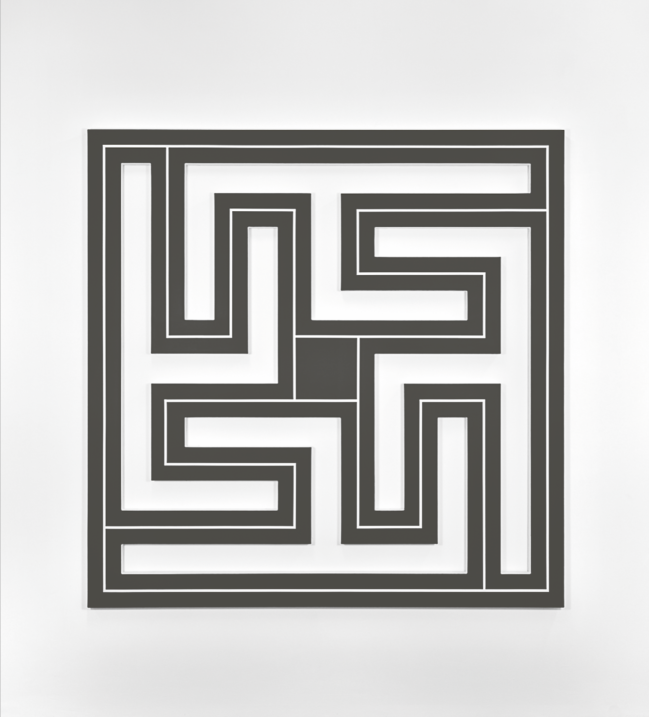
La Fondation Leenaards cherche à accompagner les mutations de la société en soutenant des projets et en stimulant des initiatives dans les domaines culturel, âge & société et scientifique, au sein de l’arc lémanique.
Dans cette édition 2022, nous vous proposons de plonger dans différents Regards, portés par des expert.e.s, artistes et autres penseur.euse.s. A l’invitation de la Fondation Leenaards, ils et elles offrent leurs réflexions personnelles sur des sujets liés aux domaines d’action de la Fondation.
Stand-by reprend, sous forme de feuilleton littéraire, les codes de la série télévisée. Des jeunes gens de l’âge de l’autrice et des auteurs parcourent un monde ravagé par une éruption volcanique, ce qui permet d’aborder sur le mode ludique le dérèglement climatique, les relations de genre, le rapport à l’altérité. Cette com- mande des Editions Zoé, une série publiée entre 2018 et 2019, est le premier ouvrage d’un collectif à trois têtes issu de l’AJAR : Bruno Pellegrino, Aude Seigne et Daniel Vuataz.
Une deuxième commande les a réunis tout récemment. Pour l’inauguration, en juin 2022, du pôle muséal Plateforme 10, situé à côté de la gare de Lausanne, le mudac (Musée cantonal de design et d’arts appliqués contemporains) a sollicité le trio pour écrire un « roman de gare ». Au contraire du foisonnement choral de Stand-by, Terre-des-Fins est porté par une seule voix, celle d’une jeune fille, Liv. Le récit se déroule dans une ville minière désertée où le train ne s’arrête que rarement. Liv et son frère sont des marginaux, ils vivent en pillant les convois qui passent. Leur passion consiste à couvrir les wagons de graffitis multicolores. Quant à la ville où ils vivent, elle a pour seule attraction l’œuvre d’un artiste qui crée avec le minerai abandonné des œuvres monumentales et toxiques. C’est alors qu’une jeune critique d’art de la capitale, venue emporter des sculptures pour une grande exposition, souhaite rencontrer l’artiste qui ne se laisse plus approcher. Liv lui fait miroiter un rendez-vous. S’ensuit la folle équipée des deux femmes.
Portrait d’une ville fantôme où rêvent deux enfants perdus, Terre-des-Fins (éd. Zoé, 2022) est un conte noir, burlesque, violent et poétique, qui interroge les dérives de l’art contemporain et célèbre la liberté du geste du/de la graffeur.euse.
Isabelle Rüf, journaliste littéraire
Michael Balavoine
Comment le Covid long vous a-t-il permis de vous réunir
autour de ce projet commun de métamodèle ?
Olivia Braillard
Le Covid long est une porte d’entrée idéale pour discuter
avec des thérapeutes complémentaires. Tout simplement
parce que la médecine conventionnelle que nous pratiquons
dans nos centres hospitalo-universitaires n’a
malheureusement pas grand-chose à proposer face à cette
pathologie. En effet, celle-ci nous oblige à sortir des
schémas classiques, y compris du fameux axe
biopsychosocial. Avec le Covid long, une grande partie de
la situation nous échappe. Il s’agit, du coup, d’élargir
les perspectives thérapeutiques et, pour cela, de
rassembler les différentes approches et de partager les
points de vue d’horizons divers. Lors de la rencontre
organisée par la Fondation Leenaards, nous nous sommes
rendu compte que le fait de réaliser un bilan ensemble
avec les patientes et patients devait être la toute
première étape. De mon point de vue de généraliste
hospitalière, c’est une occasion de faire de la «
narrative-based medicine » : on sort des données et des
chiffres pour écouter le vécu des patientes et patients.
Puis on se sert de leurs narrations comme base d’un
processus de guérison. L’idée du projet que nous menons
peut paraître banale, mais le fait de se constituer en un
groupe de soignants avec des approches très diverses pour
offrir une prise en charge la plus cohérente possible se
fait encore très peu en médecine générale. Une telle
manière de collaborer évite par ailleurs certainement des
formes d’errance thérapeutique très pénibles à vivre pour
les personnes concernées.
De mon point de vue de généraliste hospitalière, c’est une occasion de faire de la « narrative-based medicine » : on sort des données et des chiffres pour écouter le vécu des patientes et patients. Puis on se sert de leurs narrations comme base d’un processus de guérison.
Mayssam Nehme
A la consultation de Covid long du Service de médecine de
premier recours est très rapidement apparue une nécessité
absolue de coordination avec les différents professionnels
de santé et avec les patientes et patients. Pas seulement
parce que nous n’avons que peu de thérapies à proposer,
mais aussi parce que ces malades ont souvent recours aux
thérapies alternatives. Ce type d’attitude se retrouve
d’ailleurs souvent dans le cadre des maladies chroniques
telles que la douleur ou la fatigue. Or, il existe une
explosion de l’offre dans le domaine des thérapies
alternatives. Pour un médecin généraliste, savoir pourquoi
recommander une approche alternative plutôt qu’une autre
s’avère très difficile. Sans même parler de son rapport
avec la médecine conventionnelle, le domaine des thérapies
complémentaires manque de coordination. Ce projet
Leenaards va nous permettre, non pas de trouver une
solution – il faut rester humble face à cet immense défi
–, mais de commencer à réfléchir à des améliorations en
termes de coordination des soins. Laquelle constitue une
de nos tâches centrales dans un service de médecine de
premier recours.
Le Covid long nous démontre une réalité observée pour de
nombreuses autres maladies chroniques : si les médecins ne
travaillent pas en équipe multidisciplinaire, les
patientes
et patients se chargent eux-mêmes de créer cette équipe
thérapeutique autour d’eux.
René Descartes
En fait, le Covid long nous démontre une réalité observée
pour de nombreuses autres maladies chroniques : si les
médecins ne travaillent pas en équipe multidisciplinaire,
les patientes et patients se chargent eux-mêmes de créer
cette équipe thérapeutique réunissant divers
professionnels de santé autour d’eux, notamment en
provenance des médecines alternatives. Parfois, le risque
pour le patient est d’exclure le médecin dit conventionnel
de « l’équipe », par peur d’être jugé ou désapprouvé, ce
qui péjore à la fois la qualité du dialogue et celle des
soins. On se retrouve alors face à une fragmentation entre
différents acteurs thérapeutiques, agissant isolément, ce
qui entraîne un véritable risque de dysfonctionnement du
système de soins au sens large du terme.
Christophe Sauthier
Il y a ce besoin de coordination, c’est certain, mais
aussi de partage des connaissances. En tant qu’ostéopathe,
j’ai appris, lors de l’anamnèse, à éliminer ce qui n’est
pas de mon ressort et que je dois référer ailleurs. Une
fois les problèmes graves écartés, l’ostéopathe a un credo
: c’est le corps qui commande. On cherche à voir et à
sentir ce qui se passe dans les tissus. Mais, au-delà de
cette approche propre à ma pratique, comment fonctionnent
les autres thérapies complémentaires ? Ce sont cette
curiosité et ce besoin de compréhension des autres
approches que je trouve essentiels dans ce projet. Il y a
bien sûr les thérapies alternatives classiques, qui sont
déjà largement pratiquées dans les hôpitaux, comme la
méditation ou l’hypnose. Mais, dans ce projet, il y a la
volonté d’élargir le champ des possibles, d’aller à la
rencontre de modes de pensée complètement différents, pour
voir si des convergences sont possibles et augmenter le
champ d’action et d’investigation.
Il y a ce besoin de coordination, c’est certain, mais aussi de partage des connaissances. En tant qu’ostéopathe, j’ai appris, lors de l’anamnèse, à éliminer ce qui n’est pas de mon ressort et que je dois référer ailleurs.
M. B.
Concrètement, comment allez-vous organiser ce partage
?
O. B.
C’est une partie intégrante du projet, mais nous n’avons
pas de baguette magique ! Nous avons besoin d’expérimenter
par nous-mêmes pour trouver la bonne méthode. Se mettre à
plusieurs thérapeutes avec une patiente ou un patient
constitue déjà une première pour ce genre de pathologie.
Il va falloir déterminer ce dont chacune et chacun a
besoin pour mieux appréhender la pratique des autres. Un
patient partenaire a par ailleurs été intégré à la
démarche. Car l’idée de notre grille d’analyse n’est pas
qu’elle serve uniquement aux praticiennes et praticiens
pour dialoguer entre eux, mais aussi qu’elle participe à
une meilleure interaction avec les personnes malades. Car
c’est bien auprès d’elles que doivent se rejoindre toutes
les démarches thérapeutiques.
M. B.
Vous dites que cette approche intégrative est une
première. Ne devrait-elle pas être la norme pour de
nombreuses autres pathologies complexes ?
O. B.
Le cœur du travail des médecins de premier recours est de
coordonner. Ils et elles le font déjà pour la médecine
conventionnelle en rassemblant les cardiologues, les
pneumologues ou encore les infectiologues autour d’une
même situation. Réunir les avis, analyser et prendre une
décision ensemble avec le patient ou la patiente : cette
intégration est le moteur même de notre pratique. En
revanche, ajouter les médecines complémentaires à notre
pratique se fait encore peu. Néanmoins, se diriger vers
cette forme d’intégration plus large me paraît être une
évolution naturelle du travail des médecins généralistes.
Il y a trente ans dominait une médecine dite «
monopathologique », essentiellement infectieuse. Cette
médecine s’est transformée en quelque chose de plus
complexe : on soigne mieux, mais les personnes vivent du
coup avec plusieurs pathologies concomitantes. Pour faire
face à ces nouveaux besoins, il me semble dès lors tout à
fait légitime d’intégrer des approches plus larges. Les
médecins de premier recours, en tout cas en Suisse, sont
sans doute les spécialistes les plus adéquats pour
effectuer ces bilans intégratifs et jouer ainsi un rôle de
pivot entre les différents mondes de la santé. Pour
l’heure, les approches intégratives entrent encore par la
porte des pathologies pour lesquelles la médecine
conventionnelle n’a que peu de solutions à proposer. A
terme, je pense que toutes les maladies chroniques
devraient bénéficier d’une consultation intégrative. C’est
un changement culturel. Il sera certainement progressif,
mais le mouvement est en marche et il faut l’accompagner
pour le rendre harmonieux.
A terme, je pense que toutes les maladies chroniques devraient bénéficier d’une consultation intégrative. C’est un changement culturel. Il sera certainement progressif, mais le mouvement est en marche.
C. S.
En réalité, ce type d’approche qui allie les médecines
conventionnelles et complémentaires correspond déjà au
parcours que font de nombreux patients et patientes.
L’idée au cœur de notre projet, c’est de rendre ce
cheminement plus cohérent, moins informel et surtout plus
efficace. Le grand enjeu est certes d’ouvrir les
possibles, mais plus encore de veiller à ce que la
personne ne soit pas perdue avec un premier thérapeute qui
lui parle de souffle de vie, un autre de vertèbres et un
dernier du qi (l’énergie en médecine chinoise, ndlr). Notre projet vise ainsi à proposer quelque chose de
structurant autour de l’offre actuelle et à expliciter le
« qui fait quoi à quel moment» du processus thérapeutique.
Face à l’actuelle explosion des thérapies alternatives et complémentaires, les patientes et patients peinent en effet à s’y retrouver. Nous ne pouvons pas simplement les laisser livrés à eux-mêmes !
M. N.
Face à l’actuelle explosion des thérapies alternatives et
complémentaires, les patientes et patients peinent en
effet à s’y retrouver. Nous ne pouvons pas simplement les
laisser livrés à eux-mêmes ! Et même si nous manquons
encore cruellement de données et d’informations pour les
aider, nous nous devons de les accompagner le mieux
possible.
R. D.
C’est vrai qu’il faut imaginer une intégration qui soit
bidirectionnelle. D’un côté, la médecine universitaire qui
s’ouvre peu à peu à de nouvelles approches. De l’autre,
les médecines alternatives qui acceptent l’idée d’une
telle collaboration et la nécessité de mener des travaux
de recherche sur la valeur ajoutée d’une approche
intégrative pour la santé.
M. B.
Cette approche intégrative change-t-elle aussi la place
occupée par les malades ?
C. S.
Oui, c’est une manière de leur redonner les manettes. La
personne n’est plus là juste pour écouter, mais se voit
restituer le savoir qui lui appartient. Elle peut faire
des choix. Il me semble très important que chaque patiente
ou patient puisse se réapproprier cette force de décision
et déterminer ce qui est juste et important pour elle ou
lui. La personne devient ainsi un être vivant multifacette
et multidimensionnel qui interagit avec les nombreux
éléments de son environnement qui peuvent soit perturber,
soit harmoniser son potentiel de santé. Il faut dès lors
dépasser le descriptif du contenu de ce qui est vécu pour
en revenir au ressenti des patientes et patients, au
travers de leur expérience de vie. Voilà l’unicité de
chacune et chacun qui entre en jeu. Ainsi, deux personnes
dans une situation qui paraît à la base identique au
niveau des symptômes et de la pathologie ne vont en effet
pas développer la même réponse si le contexte physique,
émotionnel, mental ou spirituel est différent. Une
approche intégrative permet de prendre en compte ces
différentes dimensions dans la réponse « biologique »
donnée. Un regard plus large sur la santé est ainsi
offert.
O. B.
Il s’agit en effet d’une approche qui dépasse les soins
pour s’intéresser à l’être vivant dans sa globalité. Nous
ne sommes plus dans un schéma où un médecin reconnaît une
pathologie et prescrit le bon médicament, ni d’ailleurs
dans celui, dit « patient centré », où ce dernier reçoit
un message coordonné de plusieurs spécialistes. Non, là,
nous parlons de « personne concernée ». Le terme n’est
peut-être pas très bien choisi, mais il veut bien dire que
nous ne sommes plus dans une relation hiérarchique : tout
le monde fait partie de la même équipe. Il s’agit d’un
partenariat.
Deux personnes dans une situation qui paraît à la base identique au niveau des symptômes et de la pathologie ne vont en effet pas développer la même réponse si le contexte physique, émotionnel, mental ou spirituel est différent. Une approche intégrative permet de prendre en compte ces différentes dimensions.
R. D.
Cette vision horizontale de la situation, où chacun fait
partie d’une même équipe, est essentielle. Sur un plan
pragmatique, cela aide à recueillir et intégrer de
nombreuses informations sur la personne et ses différentes
dimensions. Des données qui pourraient sembler
potentiellement anodines dans le cadre d’une consultation
conventionnelle, mais qui ont tout leur sens dans une
approche intégrative. Dans ce cadre, il est dès lors
essentiel que la personne se sente véritablement écoutée
et entendue.
M. B.
Votre projet s’inscrit dans un service de médecine
universitaire. Est-ce le signe d’un changement de
perception et de culture dans ce milieu ?
M. N.
Dans le monde hospitalo-universitaire, il existe une
sensibilisation aux approches intégratives plus grande que
par le passé, comme c’est d’ailleurs le cas dans
l’ensemble de la société. Cette évolution n’a pas attendu
notre projet pour être initiée. En revanche, le Covid long
a permis de déstigmatiser certains symptômes, tels que la
fatigue chronique, qui peuvent parfois être mal perçus
dans les institutions universitaires. On croit encore trop
souvent que ces troubles se situent « dans la tête » des
individus. Or, l’énorme savoir-faire du monde scientifique
commence à mettre en lumière la réalité de syndromes
jusqu’ici négligés. Le Covid nous a obligés à investiguer
la physiopathologie de maladies pour lesquelles la
médecine conventionnelle n’avait que peu d’intérêt. Et
comprendre ce qui se passe dans le corps aide à une
véritable reconnaissance du problème.
Dans le monde hospitalo-universitaire, il existe une sensibilisation aux approches intégratives plus grande que par le passé, comme c’est d’ailleurs le cas dans l’ensemble de la société. Cette évolution n’a pas attendu notre projet pour être initiée.
M. B.
Ce projet représente-t-il aussi un moyen pour la
pratique de terrain de profiter des compétences du monde
académique ?
O. B.
Oui. Travailler dans un milieu universitaire permet de
mettre les méthodologies de la médecine conventionnelle au
service de la médecine intégrative. Les protocoles et la
mesure des résultats, nous maîtrisons. Dans le cadre de
notre projet pilote, nous allons dans un premier temps
suivre un petit groupe de cinq personnes. Le but n’est pas
d’obtenir des changements fondamentaux, comme une
évolution de l’échelle de la douleur. Nous nous
intéresserons davantage à leur ressenti. Par exemple,
cette approche a-t-elle permis à la personne d’être mieux
écoutée ? Y a-t-il des gains subjectifs pour elle ?
Est-elle devenue actrice de sa situation ? Dans un
deuxième temps, nous essaierons d’élargir la démarche,
avec l’objectif que ce modèle puisse sortir des murs de
l’hôpital et contribuer à une transition vers des
pratiques de soins plus larges.
M. B.
Avez-vous l’impression que le système de santé actuel
va aider à la transformation intégrative que vous
appelez de vos vœux ?
M. N.
Notre espoir est de développer et généraliser ces
approches intégratives à l’ensemble des maladies
chroniques. Pour cela, il faudrait que ces prises en
charge soient remboursées par l’assurance maladie.
Malheureusement, les récentes décisions politiques vont
dans le sens contraire. Au niveau de la tarification, le
temps de coordination remboursé a plutôt diminué pour la
gestion des maladies complexes. Or, organiser tout cela
demande du temps. Ce n’est pas qu’une affaire
d’aiguillage. Pour piloter les trajectoires individuelles
au plus près des besoins, il faut de l’écoute, un esprit
de synthèse et énormément d’échanges entre professionnels
et avec les patients. Ce travail de suivi rapproché est
crucial, mais cependant très peu valorisé.
O. B.
Nous pouvons faire cet énorme travail de coordination dans
un centre universitaire parce que, dans le cadre de la
recherche, nous pouvons nous permettre de ne pas faire de
la rentabilité l’unique priorité. Mais l’industrialisation
du système de soin rend cette mutation compliquée.
Beaucoup de choses restent à changer dans le modèle de
financement pour que ce travail de coordination entre les
différents mondes de la santé devienne possible. Pour
cela, il faudra montrer que cette approche est efficace
pour les patientes et patients.
C. S.
J’ai l’impression que si un projet comme le nôtre peut se
développer dans un centre hospitalo-universitaire, c’est
un signe que le système a déjà commencé à bouger. Non
parce qu’il l’a voulu ou que les caisses maladie le
souhaitent : ces approches intégratives gagnent en
importance parce que de plus en plus de patientes et
patients en font le choix. A la longue, leurs besoins,
leurs envies, leur curiosité obligeront le système de
santé, dans sa globalité, à s’adapter.
R. D.
De nombreuses résistances peuvent apparaître. Mais il me
semble aussi que ce mouvement vers plus d’intégration est
en marche. Il devra néanmoins faire ses preuves tant sur
le plan de l’efficacité que sur celui du respect des
coûts. Intégrer les pratiques conventionnelles et non
conventionnelles, c’est en définitive rendre le système
actuel plus fonctionnel ; c’est forts de cette conviction
que nous restons confiants pour l’avenir.
Ce mouvement vers plus d’intégration est en marche. Il devra néanmoins faire ses preuves tant sur le plan de l’efficacité que sur celui du respect des coûts.

Médecin spécialiste en médecine interne générale, Olivia Braillard travaille au Service de médecine de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) depuis 2010. En accompagnant des malades chroniques, elle développe un intérêt pour l’éducation thérapeutique du patient (ETP) ainsi que pour les approches biographiques de la relation médecin-malade.

Médecin diplômé depuis 1991, René Descartes a obtenu son doctorat de médecine en 1995. Il a par la suite suivi des formations approfondies en acupuncture et en homéopathie. Il exerce à titre indépendant depuis 1995.

Après sa formation en médecine interne générale aux Etats-Unis, Mayssam Nehme intègre le Service de médecine de premier recours des HUG dès 2016. Cheffe de projet du dispositif genevois de la coordination des soins de la personne âgée fragile (COGERIA) de 2018 à 2021 – et plus récemment coordinatrice de la consultation post-Covid aux HUG –, elle se rend compte à quel point une prise en charge holistique est nécessaire pour bien soigner les patient.e.s.

Ostéopathe diplômé de l’Ecole suisse d’ostéopathie, Christophe Sauthier travaille en cabinet privé multidisciplinaire – alliant médecine, naturopathie, acupuncture, thérapie psycho-corporelle, suivi pré et post-natal et massages – depuis 1998.
Pour documenter ses découvertes, la science médicale a l’habitude d’utiliser des graphiques et des tableaux. Tous les articles scientifiques s’appuient en effet sur des chiffres et des comparaisons. C’est ainsi qu’ils démontrent l’efficacité d’une molécule, la dangerosité ou encore l’inefficacité d’une autre. Mais cette conception « par la preuve » de la médecine ne suffit plus à faire face à la complexité des maladies chroniques. C’est ce que souligne le projet de « métamodèle intégratif » développé par Olivia Braillard, René Descartes, Mayssam Nehme et Christophe Sauthier. Pour répondre aux défis posés par le suivi de maladies sur le long terme, il faut désormais innover au niveau de l’organisation même des soins, afin d’en assurer la coordination globale et l’accès équitable. Ce qu’il faut construire, c’est un parcours sanitaire cohérent qui, du centre hospitalier expert au domicile du patient, mette en musique les compétences de nombreux.ses acteur.trice.s d’horizons divers. Le but ? Délivrer à la personne concernée le bon service, au bon moment et au bon endroit.
Il s’agit dès lors de faire évoluer le système de santé dans sa manière de fixer les règles de cette coopération complexe. Mais comment s’y prendre pour produire des connaissances dans ce domaine ? Le projet financé par la Fondation Leenaards propose une approche novatrice où le chemin de la connaissance passe par des innovations issues du terrain, c’est-à-dire d’une pratique soignante locale. Dans un travail déjà ancien, le spécialiste du changement au sein des organisations Frank Blackler écrivait que, dans ce genre de cas, la production de la connaissance résulte d’un processus en train de se faire, certes intermédié par la technologie et le langage, mais surtout localisé dans l’espace et constamment en mouvement1.
Le projet de « métamodèle » développé dans le cadre de l’initiative Santé intégrative & société est de cet ordre. Il consiste en une interaction nouvelle entre différents professionnels de santé, donnant un rôle central aux relations avec le patient ou la patiente. Son objectif est que des processus plus individualisés et plus adaptés à la complexité des prises en charge puissent voir le jour. Et son émergence est le fruit d’un échange constant entre différent.e.s acteur.trice.s. Rien ou presque n’y est défini à l’avance. Ce « bricolage » nécessaire à la production des connaissances est sans nul doute moins spectaculaire que la mise au jour d’une thérapie spécialisée. Mais il est et restera crucial pour répondre aux enjeux majeurs de durabilité et d’efficacité du système de soins.
Michael Balavoine, rédacteur en chef de Planète Santé
1. BLACKLER, F. (1995), Knowledge, Knowledge Work and Organizations : An Overview and Interpretation, Organization Studies, 16(6), 1021-1046.